Nous y voilà, la suite de la partie entamée la semaine dernière. Nous sommes allés jusqu’au bout. Jusqu’au point où la fiction et le jeu s’effacent pour ne plus laisser place qu’à l’expérience. Les investigateurs ont survécu — enfin, c’est vite dit. L’un d’eux (le mien) n’est jamais revenu intact : sa santé mentale s’est effondrée. Les deux autres ne sont pas encore tombés, mais la pente est là, lente, sournoise, irréversible.
Est-ce qu’on a « réussi » ? Franchement, personne ne peut le dire. On a sans doute accompli quelque chose. Empêché autre chose. Mais quoi ? On ne le saura jamais. On a été les témoins ou les instruments d’événements qui nous dépassaient totalement. Peut-être même les pions involontaires de forces plus anciennes que l’humanité.
Et c’est précisément là que le scénario trouve toute sa force. On ne « gagne » pas à L’Appel de Cthulhu. On ne sauve pas le monde. On ne terrasse pas le mal. On survit (peut-être). On comprend (un peu). Et surtout, on doute. C’est cette incertitude, ce flou total sur le sens de nos actions, qui rend cette fin profondément lovecraftienne.

Une table tendue… et hilare
Ce qui n’empêche pas qu’on se soit marrés ! Il y a eu de la tension, des surprises, de vrais moments d’angoisse, et aussi de grands fous rires pour relâcher la pression. L’ambiance était parfaite : une histoire mystérieuse, un univers oppressant, et ce sentiment constant d’être petits. C’était tout ce qu’on aime dans un bon scénario lovecraftien.


Côté technique : réflexions après coup
La gestion de la santé mentale, par exemple, reste un vrai casse-tête. Sur le papier, c’est central, essentiel même. Dans les faits, ça se réduit parfois à une triste mécanique de points, pas toujours facile à interpréter dans le jeu.
Cette fois, je n’étais pas MJ, et ça m’a fait un bien fou. Être derrière l’écran, surtout à L’Appel de Cthulhu, ce n’est pas une mince affaire. Les règles sont simples, intuitives, oui. Mais dans le feu de l’action, on zappe souvent les subtilités pour ne pas casser le rythme. Et pourtant, ces petits détails font toute la différence.
Les personnages eux-mêmes sont parfois frustrants à jouer : limités par leurs compétences, par leurs caractéristiques, ils échouent souvent là où d’autres systèmes leur permettraient d’improviser.
Et puis il y a le hasard. Parfois cruel. Parfois absurde. Les dés ont leur mot à dire — trop, peut-être. C’est rageant, pour les joueurs comme pour le MJ. Doit-on vraiment laisser autant de place à la chance dans une histoire d’horreur cosmique ? Le système nous pousse à lancer les dés, mais il suffit d’une suite d’échecs pour dérailler toute une scène. Et pour le MJ, cela implique de savoir réorienter la partie sans casser l’ambiance : remettre les joueurs sur la bonne piste, sans les tenir par la main. Un vrai numéro d’équilibriste.

Une expérience qui interroge
Autre source de frustration pour certains : le côté “one shot” inhérent à ce genre de scénario. On s’attache à un personnage… et il n’est jamais réutilisable. Parce qu’il est mort, fou, ou tout simplement fini. C’est un des aspects les plus durs de L’Appel de Cthulhu : les histoires sont uniques, les destins sont souvent scellés.
Mais c’est aussi ce qui les rend si puissantes. C’est ce qui fait que, plusieurs jours après, on en parle encore, on s’interroge sur ce qu’on a vraiment vécu. Parce que tout n’est pas dit. Parce qu’on ne comprend jamais tout. Parce que la peur ne vient pas seulement de ce qu’on a vu… mais aussi de ce qu’on n’aura jamais compris.

Conclusion (ou pas vraiment)
On n’a pas gagné. On ne sait même pas ce qu’on a perdu. Mais on a joué une partie de L’Appel de Cthulhu comme on en joue rarement : avec de l’ambiance, des rires, de l’angoisse, du mystère et ce goût unique d’être les marionnettes d’un univers qui nous dépasse. Et rien que pour ça, ça valait le coup.
Des pistes à creuser (notes et réflexions)
Explorer l’ambiguïté : terminez vos scénarios sans réponses claires, pour laisser les joueurs douter de ce qu’ils ont accompli. (Et même, ne dévoilez pas tout, ça pourra servir plus tard, on ne sait jamais).
Réduire le hasard : réservez les jets de dés aux moments critiques et utilisez davantage la narration.
Mettre en scène la folie : jouez les pertes de santé mentale comme des scènes dramatiques, pas seulement des chiffres.

Préparer les “échecs” : anticipez plusieurs chemins narratifs en cas de jets ratés.
Prolonger l’expérience : même si le scénario est un one-shot, réutilisez les conséquences dans une intrigue plus vaste.

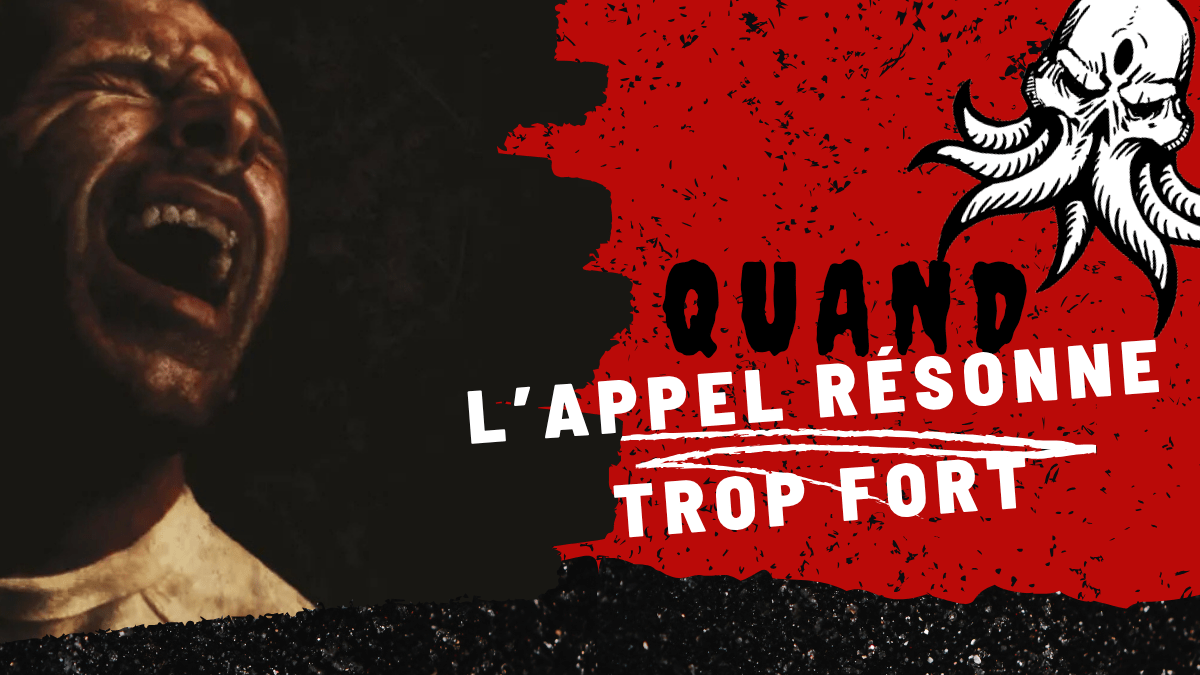
Commentaires
5 réponses à “Et quand l’Appel résonne trop fort…”
L’ambiance d’une table de jdr ferait s’évanouir les diététiciennes les plus endurcies !
C’est sûr que des chocobons, du saucisson, des crêpes, des crackers, de la tortilla, et encore d’autres trucs sucrés ou salés…. Ça méritait bien de la bière sans alcool et du coca pour faire passer le tout…
Il ne faut pas juger…
Attention à ne pas reproduire chez soi sans un entraînement préalable.
Foutu pour foutu, autant se ruiner la santé en prenant du plaisir.
Je n’avais pas le souvenir des lunettes par contre… mais bon, en ce temps-là, j’avais vingt ans !
Les fameuses lunettes »voit de loin uniquement »