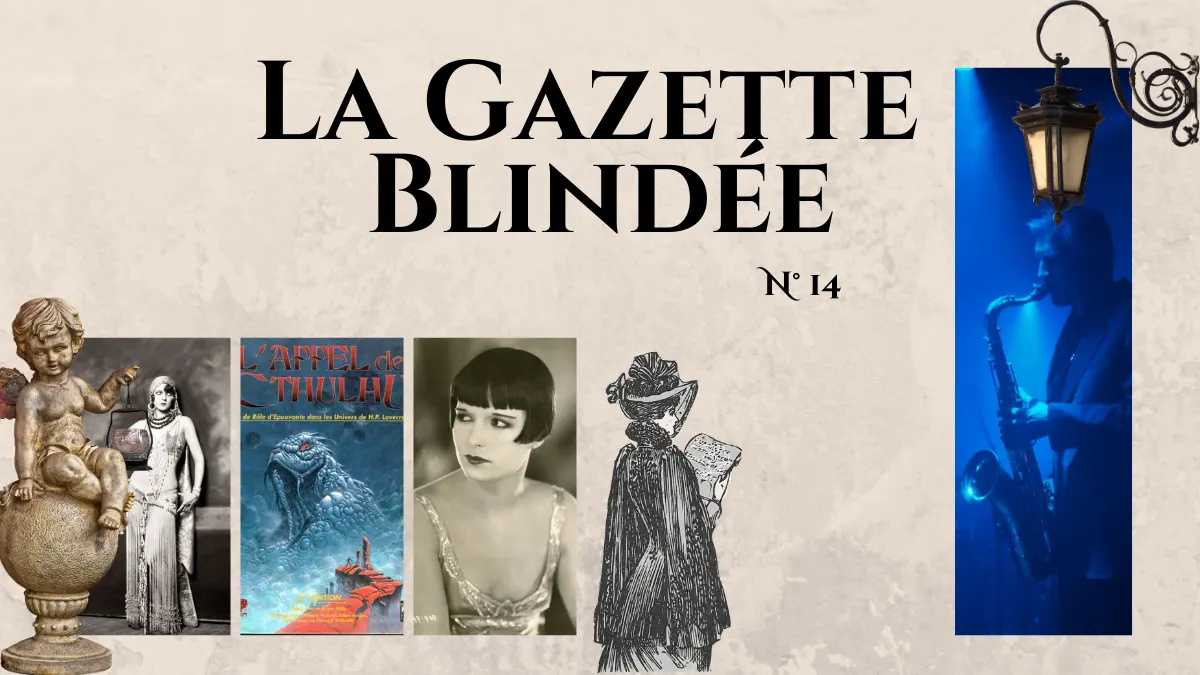Édito
Quatorze numéros déjà, et cette fois on change un peu les règles du jeu. La Gazette Blindée ne se contente plus de s’imprimer en PDF artisanal, elle se glisse directement dans votre boîte mail. Expérimentation assumée, bricolage assumé aussi : on teste, on ajuste, on verra bien. C’est l’esprit fanzine, après tout.
Pour ce numéro, on a voulu croiser les époques et les obsessions. Louise Brooks, actrice du muet, flapper récalcitrante et muse éternelle, sert de fil conducteur. Elle surgit dans un article biographique nourri de documents, mais aussi comme personnage jouable, arrachée aux pages d’anciens jeux de rôle. Elle nous entraîne vers l’Appel de Cthulhu, cinquième édition française, celle de 1993, avec sa couverture de Caza et ses pages épaisses qui ont bercé une génération de rôlistes. Elle nous pousse aussi vers des ambiances musicales : le dark jazz de Bohren & der Club of Gore, idéal pour faire planer les soirées d’enquête.
En contrepoint, un détour par les Ziegfeld Follies rappelle que derrière les plumes et les paillettes, il y avait un monde de rivalités, de scandales et de coulisses inquiétantes. Et comme on ne serait pas la Gazette si on ne glissait pas un scénario dans la besace, vous trouverez une graine de partie : La bobine maudite, une pellicule hantée qui traverse aussi bien Simulacres que Cthulhu ou Mega.
Bref, cette Gazette est un patchwork : un peu de mémoire, un peu de musique, un peu d’histoire, et beaucoup de jeu. On espère que ce format plus direct vous plaira. Installez-vous, allumez une lampe tamisée, lancez Bohren en fond sonore, et plongez dans ce numéro 14.
Louise Brooks, étoile noire du muet

Louise Brooks (1906-1985) reste l’une des icônes les plus fascinantes du cinéma muet. Danseuse, actrice, flapper, muse et chroniqueuse, elle a marqué l’imaginaire des Années folles avec sa coupe au carré et son regard sombre. Contrairement à d’autres stars du muet, elle a laissé des écrits incisifs (Lulu in Hollywood) qui témoignent d’une lucidité mordante sur l’industrie du spectacle.
Dans cette Gazette, on s’intéresse à son parcours, mais aussi à son potentiel comme personnage de jeu de rôle.
- Avec Simulacres, elle peut devenir une figure d’inspiration directe : actrice mondaine, charmeuse et libre, mais aussi curieuse et prête à se mêler de mystères.
- En L’Appel de Cthulhu v5 (édition Descartes, 1992), Louise devient une investigatrice crédible, à la croisée du monde du spectacle et des coulisses occultes.
- Nous avons même tenté de l’adapter dans Chroniques Oubliées Contemporain 2e édition : l’essai est pour l’instant décevant, preuve que certaines figures historiques se plient mieux à certains systèmes qu’à d’autres.
En parallèle, un document « réservé à un public averti » rassemble quelques photographies de Louise à l’époque des Ziegfeld Follies : témoignages visuels d’un autre temps, précieux pour qui veut recréer l’atmosphère d’une époque où le glamour flirtait avec la provocation.
[Archéorôlisme] L’Appel de Cthulhu v5 (Descartes, 1992)

On l’oublie parfois, mais la cinquième édition française de L’Appel de Cthulhu (Descartes, avril 1993, 240 pages cartonnées, ISBN 2-7408-0050-9) a été un vrai tournant. Pas une révolution, non, mais un de ces livres qu’on garde longtemps dans son sac de joueur — lourd, solide, et surtout complet.
À l’intérieur, le contenu respire la densité :
- Trois époques jouables d’entrée de jeu (1890, 1920 et 1990), avec fiches distinctes, ce qui ouvrait des possibilités qu’on exploitait rarement à l’époque.
- Plus d’une douzaine de compétences remaniées, un système de création plus généreux (deux fois plus de points à répartir qu’avant), et un bon paquet de professions supplémentaires pour varier les profils.
- Les règles de combat, d’expérience et de santé mentale détaillées juste ce qu’il faut, avec un tableau synoptique qui guidait la création — pratique quand on n’avait pas de MJ patient pour tout expliquer.
Mais surtout, c’était un livre-arsenal : bibliographie de deux pages pour fouiller au-delà, aide de jeu sur la médecine légale (piquée à Cthulhu 90), nouvelles créatures, sortilèges et même deux scénarios inédits. Ajoutez les classiques (La Maison maudite, Le Dément), et vous aviez de quoi remplir des soirées entières.
Le tout emballé dans une couverture rigide signée Philippe Caza : un visuel qui a marqué une génération, mélange d’étrangeté et de couleurs psychédéliques. Rien à voir avec les tons plus sobres des éditions suivantes : là, on avait l’impression de tenir une relique pulp entre les mains.
Alors, pourquoi évoquer Louise Brooks ici ? Parce que la v5 est pile l’édition qui permet de l’imaginer comme investigatrice :
- Années 20 : elle colle parfaitement au cadre classique de l’Appel.
- Mais on aurait aussi pu la transposer dans les Années 90 façon revenante du muet, ou en 1890 dans une ambiance cabaret fin-de-siècle.
Cette cinquième édition avait ce mérite : donner les outils pour sortir des rails. Quand on relit ses pages aujourd’hui, jaunies mais toujours robustes, on se dit que c’était une époque où les bouquins respiraient le jeu avant tout. Pas de surcouche, pas de clinquant, juste l’envie de plonger les PJ dans la folie — et ça marchait.
Musique / Ambiance : Bohren & der Club of Gore

Pour poser une ambiance à la table, rien ne vaut Bohren & der Club of Gore. Ce groupe allemand, né en 1992, se présente comme les apôtres d’un « doom jazz » qui n’a rien à voir avec le swing ou le bebop. Ici, tout est ralenti, épaissi, étiré comme une cigarette qu’on laisse se consumer dans l’ombre. Chaque note tombe au compte-gouttes, et résonne comme dans une pièce enfumée, tard dans la nuit.
Leur album Sunset Mission (2000) est devenu culte, au point de figurer dans les playlists de nombreux meneurs de Cthulhu. Le saxophone y flotte comme un spectre urbain, la contrebasse déroule des lignes graves et pesantes, le piano pulse doucement comme un battement de cœur nocturne, et la batterie, réduite à sa plus simple expression, scande une marche lente vers l’inconnu. Rien de spectaculaire, mais une lente descente vers un état d’hypnose collective.
À une table de jeu, Bohren devient un décor invisible. Les rues désertes d’Arkham prennent des teintes plus inquiétantes, les coulisses d’un cabaret où disparaît une actrice se chargent d’électricité, et même une traversée interdimensionnelle façon Mega trouve dans ces nappes sonores une étrange légitimité. La musique ralentit les gestes, rend chaque regard plus appuyé, chaque silence plus pesant.
Bohren n’est pas seulement un groupe d’ambiance. C’est une machine à distordre le temps, à envelopper les joueurs dans une transe douce et anxieuse. Exactement l’esthétique qu’on aime croiser dans les pages de cette Gazette.
Histoire & Culture occulte : Les Ziegfeld Follies

Avant Hollywood, avant même que le cinéma muet ne s’impose comme la nouvelle machine à rêves, il y avait Broadway. Et sur Broadway, il y avait les Ziegfeld Follies. Créées en 1907 par Florenz Ziegfeld, ces revues fastueuses s’inspiraient du modèle parisien mais l’américanisaient à outrance : plus de plumes, plus de paillettes, plus de chorégraphies grandioses, plus de jeunes femmes hissées au rang d’icônes. Les Follies étaient un mélange de glamour et de provocation, vitrine de l’Amérique prospère, mais aussi laboratoire d’une modernité parfois sulfureuse.
Louise Brooks n’y fut qu’une étoile parmi d’autres, mais son passage illustre bien ce que représentaient ces revues : un tremplin vers une carrière, une initiation à la scène, mais aussi un univers de rivalités, d’excès et de scandales. Derrière les projecteurs, les coulisses bruissaient d’histoires de jalousies, de liaisons secrètes et de chutes brutales. Les Follies faisaient et défaisaient des réputations, jouaient avec les limites du bon goût et de la décence, et fascinaient un public qui venait autant pour le spectacle que pour l’aura de scandale qui l’entourait.
Pour un meneur de jeu, c’est un décor rêvé. Le faste des costumes et des décors se prête à l’illusion, mais derrière le rideau, tout peut basculer dans l’occulte ou le criminel. Une revue devient un terrain propice aux disparitions, aux obsessions, aux rituels clandestins. On y croise autant des producteurs véreux que des artistes visionnaires, des collectionneurs d’artefacts étranges que des sociétés secrètes profitant de la foule pour recruter ou manipuler. Les Ziegfeld Follies sont un miroir des Années folles : éclatantes en façade, inquiétantes dans leurs ombres.

Bonus
la fiche PNJ Chroniques Oubliées Contemporain 2eme édition

Inspiration JdR : La bobine maudite
Tout commence par une rumeur qui circule dans les milieux du cinéma. Une actrice du muet aurait disparu, laissant derrière elle une ultime bobine que personne n’a encore projetée. On raconte que ce film montre autre chose qu’un simple numéro de cabaret ou une scène mondaine. Des témoins parlent d’images impossibles, de visions qu’aucun objectif n’aurait pu saisir. Certains assurent même que la pellicule tremble d’elle-même, comme si elle refusait de rester enfermée dans sa boîte.
Les personnages-joueurs sont entraînés malgré eux dans cette chasse au trésor maudit. Un collectionneur privé leur propose une somme considérable pour retrouver la bobine, un producteur hollywoodien veut à tout prix l’enterrer, un occultiste est persuadé qu’elle contient une invocation dissimulée entre les photogrammes. Très vite, la piste mène dans les arrière-salles des cinémas de quartier, les entrepôts poussiéreux où s’entassent les archives, et jusqu’aux coulisses mal famées où l’actrice aurait été aperçue pour la dernière fois.
Dans une partie de Simulacres, l’affaire prend des allures de chronique mondaine : ragots de journalistes, rivalités artistiques, et une starlette qui devient le centre d’un complot. En jouant à L’Appel de Cthulhu dans les années 20, la pellicule se révèle être un vecteur de folie pure : chaque visionnage entraîne des pertes de SAN, et ceux qui insistent trop finissent par confondre rêve et réalité. Avec Mega, la bobine devient tout autre chose : un artefact transdimensionnel, une capsule visuelle issue d’un monde voisin, que certains voyageurs veulent protéger tandis que d’autres cherchent à exploiter son pouvoir.
Quoi qu’il en soit, la bobine n’est pas un simple MacGuffin. Elle est le cœur battant de l’histoire, un objet qui attire les convoitises, piège les curieux, et pousse les joueurs à se demander ce qu’ils seraient prêts à sacrifier pour connaître la vérité. Faut-il l’utiliser, la détruire, la diffuser au monde entier ? Dans tous les cas, l’acte final se jouera dans une salle obscure, devant un écran blanc qui n’attend plus qu’à s’illuminer.