Il y a ce moment, en lisant un blog, où on se dit : « Est-ce que je ne suis pas en train de lire le journal intime de quelqu’un ? » L’impression de franchir une frontière, de voir trop loin dans l’intimité de l’autre. Et puis on se reprend : c’est bien le principe, non ? Publier un texte en ligne, c’est assumer de s’exposer. Mais le lecteur aussi prend un risque : celui d’être touché, dérangé, déplacé.
Et finalement, ce petit vertige de l’intime, on le retrouve ailleurs : autour d’une table de jeu de rôle.
L’intime numérique : le blog comme scène fragile
Internet a changé de visage. Les premiers blogs, dans les années 2000, c’était souvent ça : des fragments de journal, des aveux, des confidences. Parfois maladroits, parfois bouleversants. Le web 2.0 a un peu uniformisé tout ça derrière des posts calibrés et des réseaux sociaux, mais il reste encore des espaces où l’on ose se livrer.
La question est toujours la même : jusqu’où dire ? Jusqu’où montrer de soi ? Celui qui écrit s’expose, et celui qui lit devient témoin, complice… parfois voyeur malgré lui.


À Le personnage comme écran
Quand on joue, on ne se met pas à nu directement : on passe par un masque. Le personnage devient un filtre, un avatar, une version de soi décalée. Et c’est souvent là que l’intime se glisse.
- Un aveu déguisé : au lieu de dire “je suis en colère”, le joueur fait rugir son barbare ou fulminer son détective. C’est une émotion réelle, mais habillée de fiction.
- Un désir projeté : tester une autre identité, une autre manière d’être. Jouer un rôle, c’est aussi explorer des possibles qu’on n’oserait pas assumer “en vrai”.
- Une sécurité relative : si c’est trop sensible, il reste toujours l’excuse du masque : “c’est mon perso, pas moi”. Mais les deux sont rarement totalement séparés.
Ce qui est fascinant, c’est ce flou : on parle de nous en parlant d’un autre. Et c’est précisément là que le jeu de rôle devient puissant.
Le jeu de rôle : masques et transparences
Le jeu de rôle ludique, celui qu’on pratique entre amis, n’a pas la même fonction que le jeu de rôle en formation ou le jeu de rôle thérapeutique. Pourtant, tous partagent un point commun : on finit toujours par laisser filtrer un peu de nous-mêmes.
On se croit protégé par le masque du personnage. Mais les réactions, les tics, les façons d’esquiver ou de plonger dans une scène en disent souvent long. Le masque n’efface pas l’intime : il le filtre, il le colore, il l’amplifie.
Et comme dans la vie, tout dépend du cadre social.
- Si la tablée est bienveillante, jouer une scène personnelle ou émotionnelle devient une expérience riche et partagée. Comme une confidence faite à des proches.
- Si la tablée est toxique, la même scène peut se transformer en malaise. Ce qui aurait pu être une mise à nu constructive devient alors une exposition forcée, voire une blessure.
C’est pour ça que les rôlistes ont inventé des garde-fous : contrat social, “X-card”, limites fixées à l’avance. Parce que jouer avec l’intime, c’est puissant — mais c’est aussi fragile.
Le contrat social
Un jeu de rôle n’est pas qu’une suite de règles : c’est aussi un pacte implicite entre les joueurs et les joueuses. Quand on touche à l’intime, ce pacte doit devenir explicite.
- Poser des limites avant : chacun peut dire ce qu’il ne veut pas jouer (violence, sexe, certains thèmes sensibles). Les outils de sécurité comme les lines & veils ou la X-card sont faits pour ça.
- Jouer en confiance : savoir qu’on peut explorer sans crainte. L’intime devient un terrain fertile seulement si tout le monde se sent respecté.
- Débriefer après : prendre quelques minutes pour revenir sur ce qui a été dit ou joué, distinguer le perso de la personne, rassurer si besoin.
Le contrat social, c’est le garde-fou qui permet de transformer une fragilité en expérience partagée, sans malaise ni blessure.

Croisements : écrire, jouer, se livrer
Au fond, bloguer et jouer au JdR, ce n’est pas si différent. Dans les deux cas, il y a une mise en récit de soi.
- Le blogueur écrit son vécu et le publie, quitte à s’exposer.
- Le joueur projette une part de lui dans un personnage et la met en scène devant les autres.
Dans les deux cas, il y a un public. Le lecteur. La tablée. Parfois bienveillant, parfois jugeant. Dans les deux cas, il y a la question du “trop dire”. Et dans les deux cas, il y a une vérité étrange : ce qui semble trop personnel est souvent ce qui touche le plus juste.
La scène codée
Parfois, l’intime est plus fort quand il reste implicite. Plutôt que de dire ou jouer frontalement une émotion, on la laisse passer par un signe, un détail, un symbole.
Un silence : parfois, ne rien dire est plus parlant que mille mots. Le silence met mal à l’aise, rassure ou souligne un moment.
Un vêtement : la cravate défait, les bas repliés, le manteau abandonné sur une chaise – autant de marqueurs visuels qui en disent plus que de longs dialogues.
Un geste : un regard fuyant, une main qui tremble, une cigarette qu’on allume nerveusement. Des signaux minuscules, mais puissants.
La force de la scène codée, c’est qu’elle laisse la place à l’interprétation. Le joueur exprime quelque chose, les autres le reçoivent et le traduisent. L’intime n’est pas exposé en clair, mais il est là, palpable.

Pour finir (provisoirement)
Lire un blog intime, jouer un personnage vulnérable, c’est toujours prendre le risque de trop en dire. Mais c’est aussi ça qui fait la richesse de l’expérience : l’instant où la fiction, le masque, le récit touchent quelque chose de profondément vrai.
Et précisons-le clairement : nous ne sommes pas des psy, ni des thérapeutes. Ce qui précède tient plus de la réflexion de bistrot ou de la “psychologie de comptoir” que d’une analyse scientifique. Mais parfois, c’est aussi ça qui compte : ouvrir la discussion, faire émerger des questions, provoquer un déclic. Ce n’est pas du 100 % fiable, mais ce n’est pas complètement à côté de la plaque non plus.

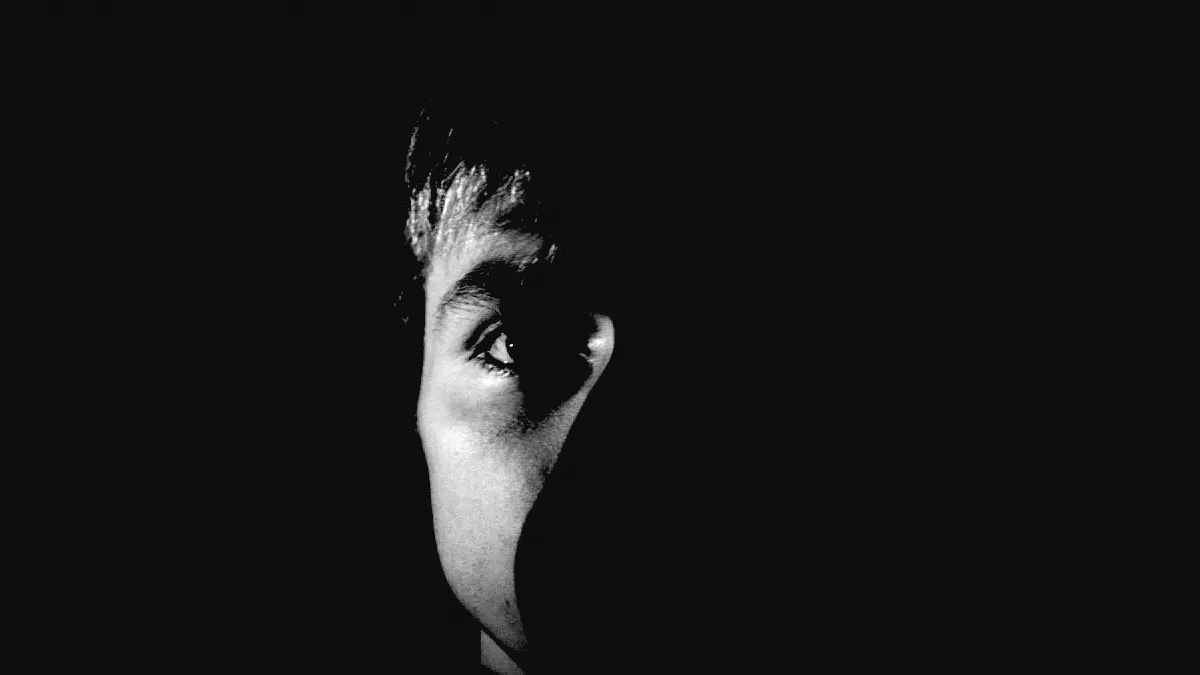
Commentaires
Une réponse à “Intime en ligne, intime en jeu : quand écrire (ou jouer) c’est s’exposer”
On peut donc parler d’une digression féconde, effectivement
En lisant l’article, j’ai repensé bien évidemment à tous les personnages que j’ai créés par le passé, et c’est clair qu’ils avaient tous une partie de moi, plus ou moins présente — que ce soit le « moi » réel ou un « moi » fantasmé, rêvé d’une manière ou d’une autre. En y repensant, je suis un peu triste de n’avoir pas eu la possibilité de les développer un peu plus, à l’époque (ma mère écoutait les émissions de Mireille Dumas…).
J’ai aussi repensé à un épisode hors jeu de rôle, où l’écriture m’a joué un tour, un épisode qui relève pour le coup de l’intimité, et que je vais raconter un peu ici. J’avais une relation épistolaire avec une fille. Je lui avais écrit un jour sur un coup de tête, elle m’avait répondu, j’avais poursuivi, et nous étions rentrés dans une sorte d’engrenage. Nos études à tous les deux faisaient que cette activité nous faisait du bien, nous permettait de décompresser — j’étais en prépa scientifique, elle était en médecine. Ces lettres que je lui écrivais étaient de plus en plus longues : une page, une feuille, deux feuilles… un soir d’été, je laissais courir ma plume sur le papier, écrivant les mots comme ils venaient. J’en étais à ma cinquième feuille quand trois mots sont venus sans que je leur aie rien demandé, trois mots dont la puissance, l’évidence, ont immédiatement tarri mon inspiration pour ce soir-là : « je t’aime ».
Toujours pour la petite histoire, cette lettre précise a finalement atteint 15 feuilles quand je lui ai envoyée. Nous sommes restés en contact pendant quelques mois après ça, même si pour diverses raisons nous n’avons pas fini en couple. Aujourd’hui, c’est de l’histoire ancienne, pourtant j’ai toujours toutes ses lettres dans un classeur chez mon père et parfois, il m’arrive de me demander ce qui se serait passé si ce « peut-être » que nous avions esquissé était devenu réalité…
Tant qu’à digresser, autant y aller à fond !